
Petit souvenir du concert le plus original auquel il m’ait été donné d’assister.
Le samedi 22 mars 2014, dans le Grand Amphithéâtre du Muséum national d’Histoire naturelle à Paris, s’est tenue une première mondiale depuis… la préhistoire ! avec la création de Paléomusique, une œuvre pour… lithophones.
Des lithophones ? Mais qu’est-ce ?
Le lithophone est un idiophone, soit un instrument de type percussions dont le son est produit par le matériau de l’instrument lui-même – ici la pierre (lithos, « pierre »).
En 2004, lors du récolement des collections du Musée de l’Homme, on s’est intéressé à des pierres étranges, qui dormaient dans les réserves, oubliées de tous depuis leur découverte dans les sables du Sahara, au XIXè siècle. Ces pierre étaient de différentes tailles, de section cylindrique pour certaines, plus aplaties pour d’autres, et on ignorait tout de leur fonction — on appelait par analogie de forme les premières « pilons », les secondes « haches », alors même que leur poids les rendait impropres à ces usages.
Tout change grâce à l’ethnominéralogiste et paléomusicologue Erik Gonthier qui, constatant qu’elles produisaient un son harmonieux et non pas un simple bruit lorsqu’on les percutait, se dit : « Tiens, tiens, ce serait-y pas des instruments de musique ? »
Bingo. Il s’agissait bien d’instruments de musique mobiles, façonnés à partir de schistes très denses, que les hommes du Néolithique saharien sont parfois allés chercher jusqu’à 1500 km de distance, afin d’obtenir ces instruments tintant comme des cloches de bronze. Datées entre 8000 et 2500 ans avant notre ère, elles sont toutes sculptées de la même façon : leur longueur doit être 4,5 fois supérieure à leur diamètre afin d’obtenir une qualité sonore optimale. Pour en jouer correctement, elles doivent être posées sur des coussinets. Les sons résonnent plus ou moins longtemps — jusqu’à 8 secondes pour un pilon noir qui constitue le « stradivarius » de la collection du muséum (et qui aurait nécessité 2 ans de travail !).
Création contemporaine pour instruments préhistoriques
Erik Gonthier a entrepris de redonner une deuxième jeunesse musicale à ces pierres. Dans la représentation de l’œuvre Paléomusique à laquelle j’ai assisté, quatre percussionnistes de l’Orchestre National de France jouaient sur un ensemble de pierres disposées en une sorte de xylophone géant, ainsi que d’une palette d’autres percussions. Ils accompagnaient une conteuse, tandis qu’en arrière-plan défilait une animation visuelle sur grand écran. C’était une création contemporaine, mais l’espace d’un instant, on se prenait à imaginer que des représentations similaires mêlant pierres chantantes, voix humaines et lumières avaient pu fasciner leurs auditoires dans des cavités transformées en auditoriums préhistoriques. C’était un concert unique — au sens strict, puisque les lithophones ont depuis regagné leurs réserves et devraient rester muets pour un bon bout de temps…
Celui-là au moins, je pourrais dire : « J’y étais ».
Paléomusique
Musique : Philippe Fénelon, création mondiale pour lithophones et bande électroacoustique, commande Radio France
Texte : Erik Gonthier, éthnominéralogiste et paléomusicologue
Comédienne : Adèle Jayle
Percussions (Orchestre National de France) : Emmanuel Curt, Florent Jodelet, Gilles Rancitelli et François Desforges


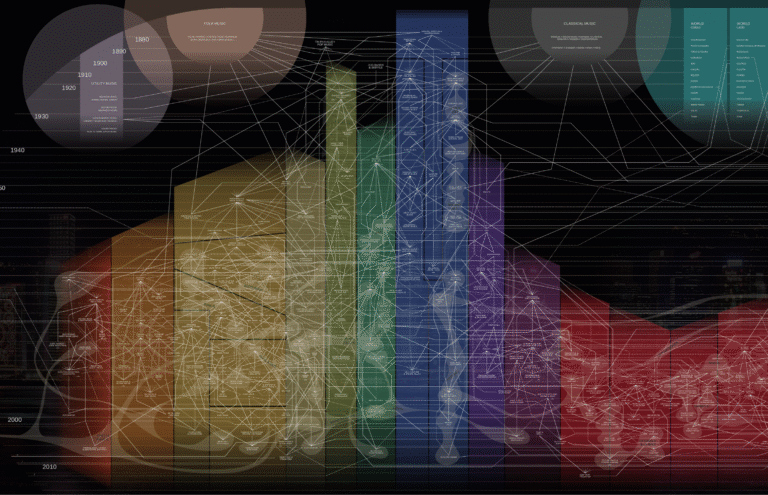

Passionnant ! Pour info, il existe sur le label ECM (CD, 1989) un très bel album pour lithophones du compositeur et improvisateur inclassable Stephan Micus, « The Music Of Stones ».